Accueil > Thèmes > La poésie > Des formes de la poésie
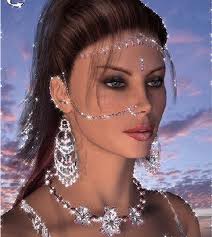 Des formes de la poésie
Des formes de la poésie
De la classique au sonnet
vendredi 25 décembre 2015, par
Prononcer à voix haute
Une récitation appliquée de votre poème peut aussi vous faire débusquer une boiterie pour un pied en trop ou en moins, un excès du pronom relatif (que-qui) venant alourdir les vers. Il peut être remplacé par un adjectif. Exemple : « qui chante » devient « chantant ». Se méfier également de trop d’adverbes en « ement », surtout à la rime : vainement, follement, tellement… ce sont d’ailleurs des mots usés. Il y a lieu de proscrire l’emploi de mots intercalés, plus ou poins à propos pour faire du remplissage, c’est ce que la prosodie note comme étant des « chevilles », celles-ci pouvant être : « alors », « comme », « donc », à ne pas multiplier.
Le poète s’habitue, à la longue, à la qualité de sons selon l’expression de ses sentiments : durs pour la colère, rapides pour la gaieté, traînant pour la tristesse et d’une prononciation aisée et coulante pour le plaisir ou la tendresse.
Haut de page
La poésie classique
Introduction
Il existe la poésie classique à "forme fixe". Ces formes fixes sont un ensemble de règles structurant un poème classique.
On trouve notamment : Le sonnet, le pantoum, la ballade, le triolet, la villanelle, le rondeau, le rondel, le lai, les iambes, la terza rima…
Respecter l’égalité dans le nombre de pieds
Hormis quelques exceptions (iambes…), les poèmes classiques requièrent l’emploi d’un nombre égal de pieds au fur et à mesure des vers. Ainsi, si le 1er vers est en alexandrin, tous les autres vers seront de même facture.
Se méfier des diphtongues
On appelle « diphtongue » la réunion dans le même mot de deux sons voyelles qui se succèdent. Ces deux sons peuvent être prononcés :
Pour savoir si un mot se compte en synérèse ou en diérèse, il faut se référer à leur origine latine. Mais le plus simple est de se reporter au tableau des diphtongue, publié dans de nombreux traités de prosodie. Déterminer les élisions :L’âme reste l ’essence de l ’Homme peut devenir, après élisions :L’âme est l ’essence humaine
L’élision est le fait d’ « aspirer » le E muet d’une fin de mot par un son voyelle débutant le mot suivant. Ceci est obligatoire dans 2 cas :
Le fait de placer un mot à élider au pluriel, ne modifie en rien l’erreur !
Eviter les échos
Il y a écho lorsque l’on trouve des sons identiques ou voisins aux endroits accentués, c’est à dire à la césure et à la rime, d’un même vers ou de vers plus éloignés. Il existe deux sortes d’écho :
Exemple d’écho à éviter :
Il est des instants où l’homme se perd
Et souvent il préfère oublier ses erreurs… Pour éviter un écho, il faut compter un certain nombre de vers entre les deux sons voisins, afin que l’oreille du lecteur n’en soit plus gênée. Certains parlent de 4 vers, d’autres 6 vers, allant même pour certains jusqu’à 8 vers ! Pour ma part, je tolère 4 vers.
Bannir les hiatus
L’ « hiatus » est la rencontre heurtée de deux voyelles autres que le E muet :
Soigner les rimes
En poésie classique, il faut faire rimer les singuliers ensemble, et les pluriels ensemble.
Il faut également alterner les rimes féminines généralement terminées par E, ES ou (l’ENT des verbes conjugués) et masculines (toutes les autres, et l’ENT des sons en « en »). De plus, une terminaison de vers féminine ne peut rimer avec une terminaison de vers masculine. Exemple : « harem » (fin masculine) et « bohème » (fin féminine) ne riment pas.
Le manque de mots pour certaines rimes ne permet pas toujours de suivre cette règle qu’on doit cependant respecter, chaque fois qu’on le peut. Mais on peut trouver des équivalences : B-P ; D-T ; F-V ; J-CH ; K-C ; N-GN ; X-C-Z
Exemples :
Don / bouton
Triompher / rêver Enfin, plus la rime est riche, plus elle est appréciée : Exemples :
écru / dru n’ont qu’un son "u" en commun
matin / satin ont par contre une rime plus riche, alliant 3 sonorités communes : "a/t/in"
Placer les césures
Placez correctement vos césures. Les formes classiques n’imposent pas toutes des césures, mais c’est le cas pour l’alexandrin (12 pieds), le décasyllabe (10 pieds) et éventuellement l’octosyllabe (8 pieds). Sauf exceptions ou idées novatrices, la césure se trouve à l’hémistiche (le milieu du vers), découpant ainsi le vers en deux demi-vers d’égale longueur de pieds.
Lier ses vers
Une strophe doit contenir le plus possible de vers se lisant à la suite, sans point. Par exemple :
En rêve je perçois, couverte de splendeur
Un être éblouissant : la rose inimitable.
Apeuré, j’aperçois l’animal redoutable
Qu’est la noble lionne, révélant son ardeur.
C’est un poème, hélas, qui contient un point, coupant le quatrain en 2 fois 2 vers distincts. Le rythme en est altéré et la fluidité également.
Par contre :
En rêve je perçois, couverte de splendeur
Un être éblouissant : la rose inimitable
Pendant que m’apparaît l’animal redoutable
Qu’est la noble lionne, révélant son ardeur. Ce poème montre la lecture d’une strophe complète dans un même élan
Haut de page
Autres formes de poésie
Pour ceux qui ne considèrent pas de très haut la « bonne poésie classique » ou qui ne peuvent s’adapter à ses règles, nous pouvons regarder d’autres formes de poésie afin de ne pas paraître sectaires.
Il existe une poésie dite « libérée » ou « néo-classique » qui laisse au poète la liberté de versifier à mesures inégales, de ne pas respecter toutes les règles. Cela peut donner ce bons poèmes si le poète a l’art de combiner ses vers, et de les assortir à l’expression de sa pensée d’une manière favorable à l’harmonie. Faisons une comparaison œnologique : il y a de grands crus dans le classique, mais il peut y avoir d’excellents petits vins dans le néo-classique.
Existe également le « vers libre » qui malgré son nom n’est pas facile à établir puisqu’il ne possède pas d’ordre symétrique. Depuis 1885 le vers dit « libre » est affranchi de toutes les règles traditionnelles du vers français, il est sans rimes, avec parfois des assonances pour ne pas faire trop prose découpée. Il est difficile de donner une définition de la poésie libre car elle est belle, plaisante, ou ne l’est pas !
Le style, les images, les sentiments vont au cœur si quelque chose de puissant ressort des cascades de métaphores. L’aventure de la poésie moderne est en route, et la poésie dite « contemporaine » part vers un dérèglement volontaire du langage, c’est parfois de l’hermétisme, des formes inattendues et cela ne correspond pas forcément à « l’esprit français » qui aime bien tout comprendre.
Richesse des rimes
Nous sommes dans la « versification » qui n’est pas un art si le poète n’est pas un peu artiste, c’est-à-dire « ne possède pas le don de la poésie ». Nous avons vu l’ensemble des procédés qu’il doit employer pour s’exprimer en bon classique. Nous allons aller un peu plus profondément comme pour une statue à ciseler. La rime a une importance capitale et plus elle sera soignée, plus beau sera le poème. Le soin c’est l’assortiment avec sa « sœur » car il faut une identité de son et non une identité d’orthographe. Bien qu’écrits différemment, les mots « puissant » et « récent », ou bien « main » et « chemin » sont de bonnes rimes.
La rime, tant masculine que féminine, se divise en « rime suffisante » et en « rime riche ». Elle est suffisante quand le son est pareil mais elle devient riche si elle a une « consonne d’appui ». Exemple : sommeil et soleil sont des rimes suffisantes. La rime masculine devient « riche » lorsqu’elle offre dans les syllabes correspondantes non seulement le même son mais la même articulation.
Exemple : amant et charmant, accablé et redoublé. La rime féminine devient « riche » quand l’avant-dernière et la dernière des deux syllabes dont elle se compose sont également articulées et consonantes, comme dans « usage » et « visage ». On voit bien que le mot « ombrage » par exemple serait moins bon, et le choix des meilleurs mots soutenant l’idée que l’on mène est le travail du versificateur. Il ne faut pas commettre l’erreur de faire rimer ensemble des sons longs et des sons brefs, des sons ouverts et des sons fermés, par exemple faire rimer « grâce » avec « place » ou « trône » avec « couronne », mais cela tombe sous le sens. Il est bon de répéter qu’il n’est pas admis de faire rimer E accent aigu (é) avec ER, ni le pluriel en S ou en X avec le pluriel « ent » (rient, jouent).
Une question grave se pose, c’est celle de la synérèse (contraction de deux voyelles) et de la diérèse (division de deux voyelles). Les mots en « ion » on en « ien » sont très souvent employés à la rime (ou dans le vers d’ailleurs) car ils sonnent bien, mais dans la plupart des cas, il y a diérèse, ce qui compte pour deux pieds comme « tentati-on », « agitati-on ». Les poètes du XXIe siècle prétendent que la « passion » perd de sa force s’il faut dire « passi-on » ! « ien » est de deux syllabes quand il termine un nom ou un adjectif d’état, de profession et ou de pays : magici-en. « ouin », « oin », « uin » est toujours d’une syllabe : témoin, arlequin, etc. Cette règle de la diérèse est laissée au choix du poète pour la satisfaction de son oreille, et la faute ne gâche pas le poème (sauf dans les concours). Edmond Rostand est le premier poète connu qui ait essayé de secouer le joug de cette tradition, mais elle sévit, et devrait donc être exposée. Des tas de mots peuvent poser ce problème de comptage de pieds, c’est le bon sens ou le goût particulier qui prévaut.
Haut de page
La métaphore
La métaphore est un procédé de langage qui consiste à donner une image abstraite à un terme concret par substitution analogique. C’est en quelque sorte une comparaison mais qui aime se passer du mot « comme ».
La métaphore s’emploie en poésie classique car elle est très poétique (si elle est bien trouvée) mais surtout en poésie libre qui doit avoir un plus joli et différent langage que la prose ordinaire. « Comme la plume au vent, femme est volage » est une comparaison qui est considérée aussi comme une métaphore.
Métaphores dans un quatrain classique :
Et pleurer la splendeur d’une belle couronne.
Ils verront à Noël le roi qui réveillonne
Quand leur épaule aura mis ses burnous. »
L’automne est ainsi décrit originalement.
Métaphores dans une poésie libre :
Sur la dune brûlante
Au milieu des iris sauvages
Dans une orgie de soleil et de lumière…
Tu m’as abandonnée
Dans les flaques glauques du destin
Trahi par la présence…
Des galets de l’oubli !
Certains poètes respectant toutes les règles de la poésie classique négligent complètement d’y mettre des rimes et cela porte le nom de « vers blancs ». La poésie qui traite de la nature, de la vie rurale ou populaire ne s’appelle plus « poésie pastorale ».
N’existe plus non plus le « madrigal » qui, d’une manière courte, renfermait une pensée ingénieuse et fine, souvent flatteuse lorsqu’il était écrit par un homme pour une femme.
Ce qui subsiste c’est le « pamphlet » qui est un écrit satirique qui attaque souvent avec violence la religion, le gouvernement, les institutions ou un personnage connu. Ce serait trop beau de pouvoir se passer de cette méchanceté.
Une mode qui s’installe est le « néologisme ». Il existe depuis longtemps mais, l’originalité aidant, l’on trouve de plus en plus de ces mots nouveaux, soit créés, soit obtenus par déformation, dérivation, composition ou emprunt. Il en est de très jolis :
Vogue avec mes vers où l’amour s’embord
Au fur et à vie, au fur et à mort
Du cortège gris de nos oubliances. »
Haut de page
Les formes fixes :
Le rondel
On peut citer l’« acrostiche » qui consiste à commencer chaque vers, et tour à tour, avec chaque lettre du titre, ce qui fait que celui-ci se détache verticalement. On use souvent d’un prénom, en hommage à quelqu’un.
Les formes fixes les plus usitées, avec chacune sa raison, sont le « rondel », la « ballade » et le « sonnet ». Le rondel est gentil, assez facile à réaliser pour les débutants et se montre épatant pour des mots d’amour, pour exprimer des souhaits ou pour émettre un souvenir ou une idée. Il est court puisque de 13 vers sur 2 mêmes rimes, et comme certains sont répétés, il n’y a que 10 vers à construire, avec 8 syllabes (ou pieds).
A supposer que la rime masculine soit A et la féminine B, il faut un quatrain embrassé ABBA, un quatrain croisé ABAB, les deux derniers étant le réemploi des deux premiers, un 3e quatrain embrassé ABBA auquel vient s’ajouter, comme en chute, le premier vers. Celui-ci ne doit pas tomber « comme un cheveu sur la soupe » mais être bien enchaîné avec le vers précédent.
Pour une bonne compréhension, le mieux est d’en présenter un modèle :
Je dis qu’il fera beau demain
Mais je veux parler d’Espérance
Il faut de la persévérance
Pour se forger un ciel serein.
Qu’il est donc joli ce refrain !
Pour me donner de l’assurance
Je dis qu’il fera beau demain
Mais je veux parler d’Espérance.
On est souvent seul, pauvre humain
Dans ce monde d’indifférence,
De changements, d’incohérence…
Moi, mon remède est souverain :
Je dis qu’il fera beau… demain !
La ballade et le sonnet sont pareillement expliqués et montrés.
Haut de page
La ballade
La ballade est moyenâgeuse, elle servait autrefois de « chanson à danser » et c’est en cela qu’elle est intéressante. Si vous construisez, bien dans les règles, une ballade, vous avez fait une chanson et vous en avez la musique toute prête puisque Georges Brassens a habillé de ses notes « La ballade des dames du temps jadis » écrite par François Villon. Souvenez-vous : « Où sont-ils Vierge souveraine ? / Mais où sont les neiges d’antan ? »
Voici la composition de la ballade qui se fait avec des vers de huit pieds. Il y a trois couplets et demi, ce dernier servant de refrain à l’occasion. Le tout se joue sur trois rimes et il faut donc choisir ces rimes dans des sonorités qui se retrouvent facilement dans des mots. Chaque couplet est de huit vers avec cette disposition de rimes : ABABBCBC. Les trois couplets se terminent par le même vers, ce qui créé un leitmotiv (reprise). Le demi-couplet final qui se nomme « envoi » commence par un joli mot comme « Prince » ou « Amour » (mot court) et reproduit l’ordre de la 2e partie du couplet, soit BCBC. Les trois couplets se terminent par le même vers et l’ensemble compte donc 28 vers.
Ne sachant pas ce qu’il en est des droits d’auteur, ou de reproduction… quoique Villon soit mort depuis longtemps, c’est une autre ballade qui vous est proposée, et le langage est d’ailleurs plus actuel qu’au XVe siècle.
J’avais une grande maison
Qui n’avait rien d’une chaumière
Avec des roses au balcon
Un joli parc.. une volière
J’ai vendu ma gentilhommière
Une belle a tout grignoté
Me prenant dans sa souricière
Sous le Pont-de-la-Charité !
Je possédais un étalon
Un pur-sang à blanche crinière,
De l’argent : des « Napoléon »
Et même un titre nobiliaire !
Suzon m’a mis sur la litière
Ma montre est au Mont-de-Piété
Je pardonne et mords la poussière
Sous de Pont-de-la-Charité !
Paris la nuit… Paris-Néon
Oui Paris, la ville-lumière
Tôt de ma fortune eut raison
Sur les pas de ma cavalière
Je suis de façon singulière
Mis au ban de la société
Je touche le creux de l’ornière
Sous le Pont-de-la-Charité !
Envoi
Prince des gueux à ma manière
L’amour ne m’a jamais quitté
Je rêve à mon aventurière
Sous le Pont-de-la-Charité !
Le sonnet
Les règles actuelles sont les suivantes : les 14 vers doivent être en alexandrins, sinon ce n’est plus un sonnet mais un « sonnetin ». Les sentiments ou les descriptions qu’il exprime doivent être d’une bonne tenue. Le sonnet comprend deux quatrains qui sont de semblable construction, c’est-à-dire de mêmes rimes et pareillement enfermées. Viennent ensuite deux « tercets » (trois vers). Les deux premiers vers du premier tercet riment ensemble, le troisième vers rime avec le second vers du second tercet. Le premier vers du deuxième tercet rime avec le vers final, ce qui donne : ABBA-ABBA-CCD-EDE. L’idée essentielle doit s’exprimer dans le dernier vers qu’on appelle la « chute » ou la « médaille » qui demande donc une pensée ingénieuse ou un trait brillant qui frappe l’esprit. Pour plus de compréhension, visualisons un sonnet qui n’a pas de fautes de prosodie mais sans doute pas toutes les perfections. C’est ce que nous allons voir !
Le souvenir de toi dans ma tête bourdonne
Tel un insecte fou venant me tracasser,
Je voudrais d’un seul geste à jamais le chasser…
Pour cela faudrait-il qu’enfin je te pardonne ?
Il est dur d’être un jour celle qu’on abandonne
– Cœur ardent et fragile à ne pas fracasser ! –
Etais-je possessive ? Oui… j’ai dû te lasser
A toujours exiger tout autant que je donne !
S’écroulèrent ainsi nos projets d’avenir,
Disparu le pasteur qui devait nous bénir
Puisque l’on a détruit l’adorable chapelle !
Et seule a survécu cette vieille rancœur,
Blessure qui m’assaille et que je te rappelle,
Moi qui te vois vieillir, ni vaincu, ni vainqueur !
Haut de page
La poésie... Un art !
Regards sur la poésie
Si l’on se reporte au véritable sens du mot « poésie », et par conséquent à son étymologie, il faut recourir au grec. Il vient du verbe « poiein » qui veut dire « fabriquer », ce qui donne à croire qu’il y a tout de même un certain travail dans la poésie et non des mots venus tout droit du ciel ! L’artisan-poète a besoin certes de sa sensibilité mais aussi d’outils tels qu’un bon style, une richesse de vocabulaire avec, en plus, des règles de versification si l’on aborde la poésie classique. Les dictionnaires de rimes et de synonymes aident éventuellement au ciselage de celle-ci. Pensons au travail de l’artisan et nous saurons du même coup ce qu’il faut d’amour, de patience, d’adresse et de persévérance pour faire un poème digne de ce nom. Sinon il faut fréquenter une autre Ecole, celle de la facilité !
La spontanéité n’est souvent qu’un premier jet dont la plupart des créateurs se contentent. L’inspiration est un courant qui met en état de grâce mais, quand la lumière nous a visités, il reste tout un travail à faire pour que les mots acquièrent cette petite « musique » qui alertera celui qui aura alors envie de partager notre poésie. Ecrivons, mais écrivons bien, car plus sera dépoétisé le monde, par la dépersonnalisation des êtres, par la pollution de la nature et le délire des machines-robots, plus la poésie prendra de force par besoin vital de sentiments et d’harmonie. Voici deux beaux vers de Robert Laval :
Le miroir du bonheur, offre-lui la beauté ! »
